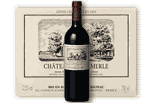CLASSEMENT 2026 DES GRANDS CRUS CLASSES DE SAUTERNES EN 1855
![]() PREMIER CRU SUPERIEUR
PREMIER CRU SUPERIEUR
![]() Château Yquem
Château Yquem
![]() PREMIERS CRUS
PREMIERS CRUS
![]() Château Premiers Crus
Château Premiers Crus
![]() Château La Tour Blanche
Château La Tour Blanche
![]() Château Lafaurie-Peyraguey
Château Lafaurie-Peyraguey
![]() Château Clos Haut-Peyraguey
Château Clos Haut-Peyraguey
![]() Château de Rayne Vigneau
Château de Rayne Vigneau
![]() Château Suduiraut
Château Suduiraut
![]() Château Coutet
Château Coutet
![]() Château Climens
Château Climens
![]() Château Guiraud
Château Guiraud
![]() Château Rieussec
Château Rieussec
![]() Château Rabaud-Promis
Château Rabaud-Promis
![]() Château Sigalas Rabaud
Château Sigalas Rabaud
![]() SECONDS CRUS
SECONDS CRUS
![]() Château de Myrat
Château de Myrat
![]() Château Doisy Daëne
Château Doisy Daëne
![]() Château Doisy-Dubroca
Château Doisy-Dubroca
![]() Château Doisy-Védrines
Château Doisy-Védrines
![]() Château d'Arche
Château d'Arche
![]() Château Filhot
Château Filhot
![]() Château Broustet
Château Broustet
![]() Château Nairac
Château Nairac
![]() Château Caillou
Château Caillou
![]() Château Suau
Château Suau
![]() Château de Malle
Château de Malle
![]() Château Romer du Hayot
Château Romer du Hayot
![]() Château Romer
Château Romer
![]() Château Lamothe
Château Lamothe
![]() Château Lamothe-Guignard
Château Lamothe-Guignard
Etabli en vue d’une présentation des vins de la Gironde, dans le cadre de l’Exposition Universelle de Paris, à la demande de l’Empereur NAPOLEON III. La rédaction du classement fut confiée, par la Chambre de Commerce de Bordeaux, au «Syndicat des Courtiers de Commerce» auprès de la Bourse de Bordeaux. Sa mission était d’officialiser une classification basée sur l’expérience de longues années et qui correspondait à la reconnaissance de la qualité du Terroir et à la notoriété de chaque cru. Les éléments furent puisés aux meilleures sources. Publié le 18 avril 1855, le Classement fut donc le point d’aboutissement d’une réalité de marché et d’une évolution existante depuis plus d’un siècle
![]() HISTORIQUE DU CLASSEMENT
HISTORIQUE DU CLASSEMENT
Dans le Bordelais, c’est dans la seconde moitié du XVIIème siècle qu’apparaît la notion de cru. En effet, on distingue déjà quelques grands vins issus d’un terroir particulier, œuvres de propriétaires fiers de la qualité de leurs produits. C’est le cas, pour les vins rouges, du fameux quatuor : Haut-Brion, Latour, Margaux et Lafite. Parallèlement, en Sauternais, les grands domaines accèdent à cette notoriété officieuse. Leur spécialisation dans la genèse de blancs liquoreux issus de la pourriture noble les y a aidés. D’autant qu’après la période de la Révolution et de l’Empire, sinistre pour le commerce bordelais et les exportations de vins, la Monarchie de Juillet assure enfin la reprise : le Sauternais plante et replante, les vendanges par tries se généralisent et les nouveaux clients de Bordeaux, Allemands, Hollandais et Belges, s’intéressent de près aux grands liquoreux. À l’instar des Anglais et des Russes, qui recherchent le nec plus ultra, donc les élixirs sauternais.
À la différence d’autres régions, où le cru peut couvrir un terroir commun à plusieurs propriétaires et même à deux ou trois villages, à Bordeaux il correspond à une exploitation viticole appartenant à une A.O.C., qui vend un vin produit sur cette exploitation ou la partie de l’exploitation que désigne le cru. Le terme «château» est devenu, en Bordelais, synonyme de cru, même si le dit château n’est qu’une humble bâtisse. En Sauternais, les bâtiments sont presque toujours un château au sens architectural et certains chais, anciens ou ultra-modernes, sont à la fois fonctionnels et esthétiquement réussis.
Cette notion de cru est tellement présente dans les années 1850 que la production d’Yquem, de Coutet ou de Filhot intéresse au plus haut point les courtiers et que ces grands vins sont désormais recherchés à Paris et dans les cours royales ou princières d’Europe centrale et orientale où le marquis de Lur-Saluces, très actif, a su les mettre à la mode. À tel point que le prix du tonneau double en vingt ans. C’est l’époque heureuse où, l’on s’en souvient, le négociant Focke et le marquis de Lur-Saluces profitent du hasard heureux que rappellent deux contes... plausibles.
Tout est donc en place, en 1855, sous le Second Empire, lorsque dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris, où chaque département exposera ses productions marquantes, la Chambre de Commerce de Bordeaux demande au Syndicat des Courtiers de proposer un classement des plus grands vins. Ces courtiers, à juste titre, sont considérés comme des professionnels intègres et indépendants qui fréquentent le vignoble, dégustent, contribuent à établir les prix. Ils sont d’ailleurs des officiers ministériels nommés par décret. Dans le préambule au classement proposé, ils assurent s’être «entourés de tous les renseignements possibles». C’est qu’ils étaient en possession de nombreuses archives des décennies précédentes et de leurs propres notes de dégustation, étonnamment précises. Un peu inquiets des lourdes responsabilités dont ils sont investis, ils signalent timidement que leur liste peut «éveiller des susceptibilités» et qu’ils n’ont fait que “soumettre un travail aux lumières”, celles de la Chambre de Commerce. Dans les vins rouges, seuls les crus du Médoc et le Château Haut-Brion furent classés, en cinq catégories. Pour les vins blancs, seuls les Sauternes et Barsac furent retenus. Un unique «premier cru supérieur», le Château d’Yquem, était distingué et jugé hors classe. Il était suivi de neuf premiers crus et de onze seconds crus. La hiérarchie semblait donc plus stricte dans le Sauternais deux catégories au lieu de cinq.
Ce célébrissime classement s’appuyait en fait sur plusieurs classifications antérieures, respectées et vérifiées par la hiérarchie des prix pratiqués. Il ne suscita aucune protestation puisque les courtiers se contentaient de récompenser des châteaux qui avaient largement fait leurs preuves.
Les grands crus classés de Sauternes et Barsac bénéficièrent de la publicité qui leur était implicitement faîte. Ainsi, en 1859, le frère du tsar de toutes les Russies, le Grand Duc Constantin, paya 20.000 francs le tonneau un Yquem de 1847. C’était un prix extraordinaire, quatre ou cinq fois plus cher que Latour ou Margaux ! Dans les deux décennies qui suivirent, les crus du Sauternais dépassèrent souvent les seconds crus médocains et plusieurs fois les premiers. Leur notoriété était désormais établie et cette prospérité, dont toute la région bénéficiait, explique le retour en Sauternais de vieilles lignées aristocratiques, les Pontac, Sigalas, Rolland et bien d’autres.
Au-delà de la terrible crise du phylloxéra, qui s’est d’ailleurs répandu moins vite dans le Sauternais, les grands crus classés ont à nouveau connu des années fastes. Comme le goût pour les moelleux et les liquoreux s’était largement répandu entre les deux guerres, ces vins supportèrent gaillardement la crise de 1929. C’est à partir de 1950 que l’horizon devint très noir, avec une inquiétante désaffection pour les vins blancs et, à l’inverse, un vif engouement pour les vins rouges. Les années soixante furent tout aussinéfastes, cette fois pour des raisons climatiques : beaucoup d’investissements furent stoppés.
Le renouveau date des années 80, avec le très bon 83 et l’excellent 86, comparable au magnifique 1937. Il s’explique par l’intérêt nouveau porté aux grands vins du Sauternais par la presse nationale et, surtout, internationale, et par les nouvelles modes de consommation. Mais les raisons déterminantes, ce sont la résistance, longue et parfois épuisante, de la plupart des grands crus, et les achats de quelques autres par des hommes qui se sont littéralement épris du vignoble et l’ont restauré. La leçon qu’il faut en tirer est finalement : limpide le classement de 1855, qui précède de très loin l’apparition des appellations contrôlées, a suscité un esprit de responsabilité qui se propage de génération en génération, il y aura bientôt cent cinquante ans. «Ne pas faillir à l’honneur qui nous a été fait», telle semble être la devise exigeante des 26 châteaux regroupés dans le Syndicat des Crus Classés de Sauternes et Barsac, qui représentent près de 45 % de la superficie plantée et 70 % du chiffre d’affaires.
.jpg)